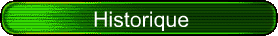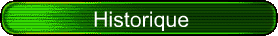|
Le blason du 17e porte la
trace de l'histoire de l'arrondissement. La grenade enflammée exprime la
défense héroïque de la barrière de Clichy par le Maréchal Moncey, le 30 mars
1814. Les bâtisses (étymologie de Batignolles) sont symbolisées par les
chevrons. La forme engrêlée de la bordure évoque le quartier des Epinettes. Le
chef rappelle la présence de la famille d'Orléans, Plaine Monceau.
|
|
 Au XIXème siècle : Au XIXème siècle :
|
|
|
Notre quartier n’est constitué que de champs et
maraîchages ainsi que des prés ou déambule les troupeaux. Les quartiers de Monceau, Batignolles et des Epinettes
appartiennent à la commune rurale de Clichy, aux portes de Paris.
|
|
|
En 1814, des travaux de terrassement sont entrepris au début
de cette année.
|
|
|
En mars 1814, les armées étrangères constituées de 800.000
soldats de l’Empire napoléonien (qui touche à sa fin), forcent les barrières de
Belleville et Pantin, puis prennent la butte de Montmartre. Près de 70.000
hommes de la Garde Nationale protèges le nord et le nord-ouest de la capitale.
Devant l’avancée des armées ennemies, le maréchal
MONCEY rassemble 15.000 hommes volontaires (tirailleurs, élèves des Ecoles
polytechnique et vétérinaire), afin de constituer ses troupes pour défendre la
barrière de Clichy (appelée aujourd’hui Porte de Clichy).
Malgré
le manque d’expérience des volontaires, cela ne les empêche pas de résister
vaillamment au contingent russe, jusqu’à la proclamation de l'armistice du 30
mars 1814.

Barrière de Clichy le 30 mars 1814
Le
maréchal MONCEY fait parti des personnes qui avec NEY, incitent NAPOLEON à abdiquer, selon le
vœu des autres officiers (on peut voir se dresser au centre de la place Clichy,
le monument du maréchal MONCEY, sur un piédestal haut de 8 mètres et ornée de
bas-reliefs, un groupe en bronze haut de six mètres dû à DOUBLEMARD représente
la défense de Paris par ce maréchal).
|
| |
En 1830, suite
à leurs expansions, les villages de Monceau et des Batignolles deviennent indépendants. Le
village des Batignolles entraîne avec lui la partie encore entièrement agricole
du lieu-dit des Epinettes, dont la première mention est retrouvée en 1693 dans
un contrat d'échange de terres.
|
|
|
En 1833,
ouverture du cimetière des Batignolles qui occupe une grande partie de la zone arrière du bastion 43, avant l'édification des fortifications.
|
| |
En
1837, avec
le début de la révolution industrielle, qui accompagne l'essor des chemins de
fer, les évolutions de Monceau et des Batignolles divergent, la construction de
la ligne de Paris à Saint- Germain, projet d'Emile Pereire à l'origine du
réseau ferré. La gare Saint Lazare est inaugurée cette année.
|
| |
Le 05
avril 1841, Louis PHILIPPE, roi de France et son 1er
ministre Adolphe THIERS décident en toute hâte de faire ériger une ceinture
fortifiée devant Paris, car des tensions internationales commencent à
apparaître au sujet de l’Egypte. Le but de cette ceinture fortifiée n’est pas
pour la défense de la capitale contre les ennemis étrangers, mais plutôt pour
maintenir un important contingent de troupes, pour mater les fréquentes émeutes
insurrectionnelles.
L’enceinte fait le tour de Paris sur 33 km de long,
elle est composée :
D’une route
militaire intérieure, De
nombreux bastions, D’un
parapet de 6 mètres de large courant sur les courtines et bastion, D’un
mur d’escarpe d’une épaisseur de 3,5 mètres et de 10 mètres de haut D’un
fossé sec de 40 mètres, D’une
contrescarpe en pente légère. D’un
glacis de 250 mètres de large.

Les
fortifications de Thiers fin XIXème siècle le
long du 17ème arrondissement de Paris
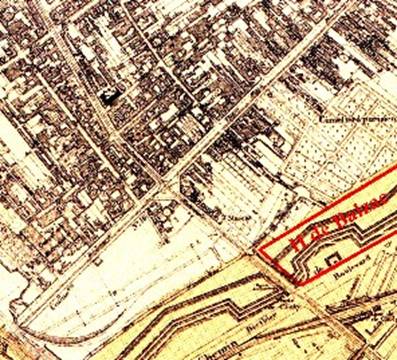
Les
fortifications à la fin XIXème siècle en
gros
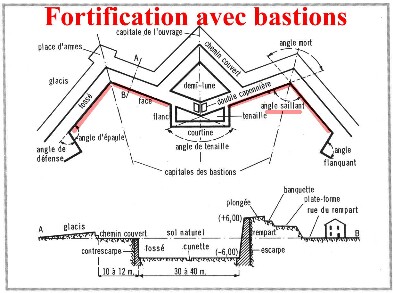
Plan, profil
d'un bastion (Larousse)
|
| |
En 1845,

L'habitat
populaire aux Batignolles en 1845
|
| |
En 1846, la
construction des nouvelles fortifications de Paris est achevée, elle remplace
l’enceinte des fermiers généraux des Temps modernes.
|
| |
En 1847, création de la rue de la
cité des Fleurs.
|
| |
En 1855,
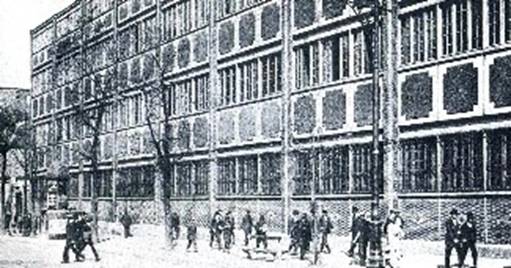
Les
ateliers ferroviaires Gouin aux Epinettes en 1955
|
| |
Avant 1860, la porte de Montmartre dans le 18ème
arrondissement est ouverte dans le saillant du bastion 38, pour contrôler
l’entrée du chemin de Montmartre, territoire de Saint Ouen devenu l’avenue de
la porte de Montmartre, et le chemin des Portes Blanches, devenu la rue du
Poteau (18ème arrondissement).
Tout le territoire compris à l'intérieur des
fortifications est annexé à la commune de Paris et naissent officiellement les
quartiers des Batignolles et celui des Epinettes.
|
| |
En 1860, la porte de Saint Ouen est percée dans la courtine,
entre le bastion 39 (ancien Hôpital Bichat) et le bastion 40 (1er
bastion du 17ème arrondissement).
La porte de Montmartre dans le 18è arrondissement (du
nom de Poterne Montmartre *1 avant 1860), est ouverte dans le
saillant du bastion 38 pour contrôler l'entrée du chemin de Montmartre.
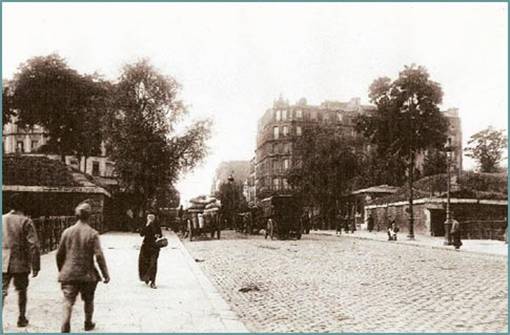
Porte
de Saint-Ouen vue du côté Saint-Ouen. À gauche, la courtine du bastion 39, à
droite la courtine du bastion 40
*1 Une poterne est
une petite porte qui était intégrée aux murailles d'une fortification, de façon
discrète et qui permettait aux habitants du château de sortir ou rentrer à
l’insu de l’assiégeant.
|
| |
En 1870, Paris est assiégé durant la guerre, par les forces
prussiennes qui ouvrent de nombreuses brèches dans le mur d’enceinte, à coup de
canon longue portée.
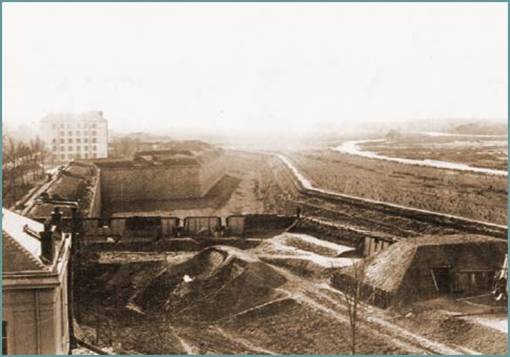
Fortification
face au bd Lannes. Vue prise au début du siège de 1870 des toits de la
gendarmerie enserrant le bastion 56. Au 1er plan, le dessus du bastion 56 et
son canon, au second plan, le bastion 7, son escarpe, son fossé, la contre
escarpe en terre coulante, le chemin de ronde et le glacis sur lesquels tous
les arbres du bois de Boulogne ont été sectionnés pour dégager le tir et le
regard

Les fortifications

Les fortifications
|
| |
De
septembre 1870 à octobre 1871, pendant le siège de
Paris, se trouve un canon longue portée qui éveille la curiosité des parisiens.
Ce canon de la marine nommé « Joséphine », de 190mm monté sur un
prototype d’affût à éclipse qui est inventé par le vice-amiral LABROUSSE. Cet
affût est destiné aux canons des tourelles des navires. Il permet de charger le
canon et de pointer le tir à l'abri derrière le parapet de l'enceinte. Le tir
s'effectue en "barbette", c'est à dire au-dessus du parapet. Le canon
se rehausse automatiquement en gardant tous les paramètres de visée. Le tir
effectué, le canon se replace immédiatement derrière le parapet, en protection.
Il est servi par une quinzaine de matelots et trois chefs de pièce. Une
description détaillée de "La Joséphine" est lisible sur le site de la
BNF, Gallica, en recherchant l'ouvrage "La Marine au Siège de Paris"
par l'Amiral La Roncière-Le Noury (baron), commandant en chef de la division de
marins détachés à Paris.
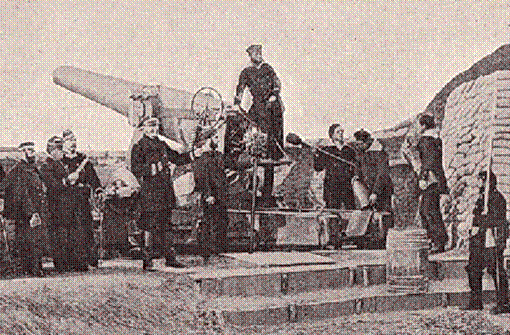
La
Joséphine sur le bastion 40
Au début
du siège, pour 0,50 FF les parisiens aiment visiter l'enceinte bastionnée en
utilisant le chemin de fer de ceinture. Nombreux sont ceux qui descendent à la
station de Saint-Ouen pour contempler ce canon. Ce canon fut en fait de peu d'utilité, car les efforts des
prussiens ne se sont pas portés sur le côté Nord-Ouest des fortifications.
|
| |
En 1875, un tunnel est creusé au
milieu de la courtine 40/41, pour permettre la communication ferroviaire entre
le réseau du chemin de fer et les docks de Saint-Ouen. A sa sortie sur le
boulevard Bessières, une sorte de grand portail décoratif est réalisé avec deux
petits corps de garde. A l’ouest, entre le flanc est du bastion 41 et le
tunnel, une ouverture est insérée dans la muraille pour permettre à une petite
voie appelée « rue du Port-Saint-Ouen» (qui finit en impasse à 600m du
boulevard Bessières), de déboucher dans la campagne. Elle prit alors le nom de
Louis Ezechiel POUCHET (1748-1809), industriel auquel sont dus d’importants
perfectionnements dans le tissage du coton.
|
| |
En 1879, suite à la démolition d’une partie des bâtiments de
l’ancien Hôtel-Dieu annexe, occasionnée par la destruction du Pont-au-double,
on transforme en hôpital l’ancien poste caserne du bastion 39.
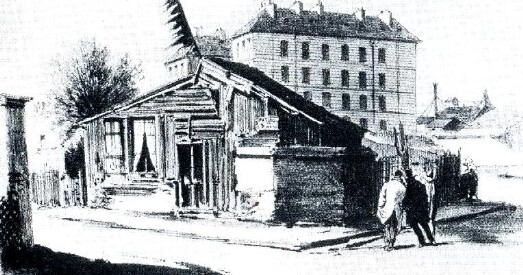
La rue de la Jonquière (en face de
Balzac) au premier plan et en second plan la caserne en 1879
|
| |
En mars 1882,
les travaux dirigés par l’ingénieur TOLLET se terminent et, le 1er décembre,
l’hôpital ouvre ses portes. Il comporte deux ailes en saillie, délimitant une
cour étroite fermée par des grilles réunies au centre par l’ancien corps de
garde transformé en conciergerie. On ajoute sur le côté deux pavillons de
briques parallèles aux ailes du bâtiment primitif.
L’hôpital dédié au médecin Marie-François- Xavier BICHAT
(1771-1802), il dispose alors de 181 lits.
De Paris vers la banlieue, se trouve successivement
un boulevard militaire de 7,30 m sur l'emplacement du boulevard Bessières
actuel, puis des buttes gazonnées, un fossé et enfin un glacis. C'est le site
principal qui borde les fortifications proprement dites, en direction de la
banlieue se situait une zone "non aédificandi" de 250m. Elle
n'intéresse que la partie du collège actuel, là où le terrain est le plus large
et également la partie arrière de l'ensemble des constructions sur la rue
Rebières.
|
| |
En 1883, le cimetière des Batignolles est de nouveau
agrandi. Dans la partie la plus ancienne de ce cimetière, d'illustres
personnages du XIXème siècle y reposent : le poète Verlaine et André
Breton. Les portes ouvertes en différents endroits de Paris qui permettent de franchir
la ligne de fortifications, tiennent lieu de péage, c'est les passages de
l'octroi dont la porte de Clichy fait partie.
|
| |
En 1893, ouverture du square des
Epinettes.

Square des Epinettes

Square des Epinettes
|
| |
 A la fin XIXème siècle : A la fin XIXème siècle :
|
| |
Le nord des Batignolles est marqué par l'emprise
ferroviaire, voies ferrées, gares de marchandises, ateliers, le nord des
Epinettes voit s'installer des entreprises artisanales et industrielles tels
les ateliers de construction Gouin qui fabriquent des locomotives et autres
machines, mais on trouve aussi une usine à gaz, des dépôts de voitures.
La population des travailleurs s'y installe en
partie, ainsi que dans le sud de ces deux quartiers où s'ajoute une population
plus diversifiée.
|
| |
 Au XXème siècle : Au XXème siècle :
|
| |
Les fortifications s'avèrent inutiles. L'idée de
Paris ville ouverte mûrit. Les fortifications sont d'ailleurs entrées dans la
mentalité parisienne de cette époque, comme un lieu de loisirs et de détente.
Les "Fortifs" sont un but de promenade du dimanche et des jours de
fête. La désindustrialisation de Paris intra-muros commence.
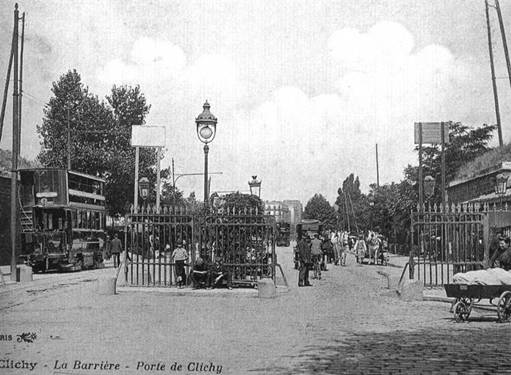
Porte de
Clichy en 1900
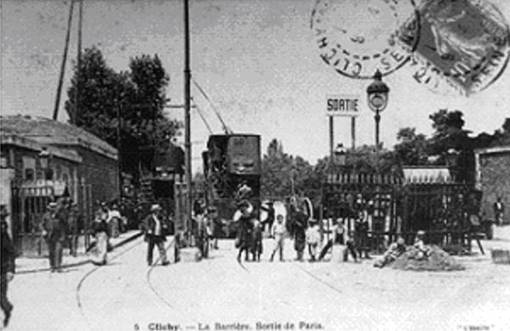
Porte de Clichy en 1900
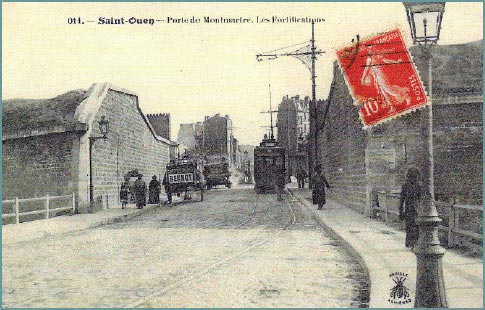
L'un
des deux principaux axes de passage entre Paris et Saint-Ouen vers 1900 avec la
Porte de Clignancourt : la Porte Montmartre
|
| |
En 1902,
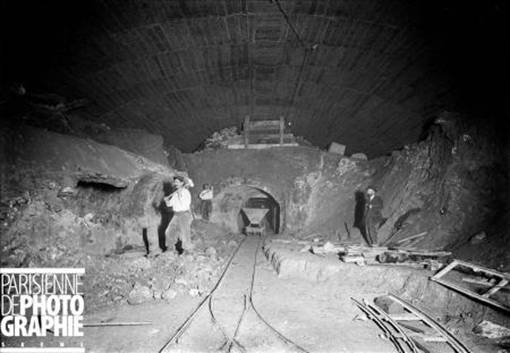
Station de métro Clichy le 17 mars 1902
|
| |
En 1905, la seconde ligne métropolitaine de la gare Saint-Lazare à la Porte de
Saint-Ouen est tracée, entre 8 et 14m de profondeur pour se terminer dans les
marnes, sous les fortifications.
|
| |
En 1913,
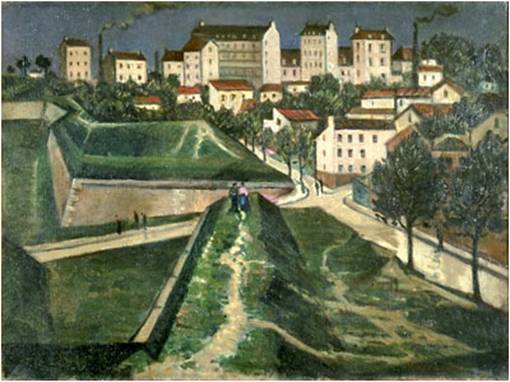
Les
fortifs peints par NEVINSON en 1913
|
| |
Le 19 avril 1919, les fortifications sont
désaffectées ainsi que la zone "non édificandi" concédées à la ville
de Paris. Cette dernière envisage de créer des espaces verts sur la zone
militaire et livre une grande partie des terrains des fortifications au
lotissement social de type HLM et
pour des équipements sportifs, mais l’emplacements
des fortifications fait d'abord place à des terrains vagues, souvent désignés
par le terme « la Zone ».
« La
Zone » n'est pas à proprement dit, l'emplacement anciennement occupé par
le mur d'enceinte, mais une bande de terre non constructible en avant du mur
d'enceinte, de son fossé et de la contrescarpe qui mesurait 250 mètres de long.
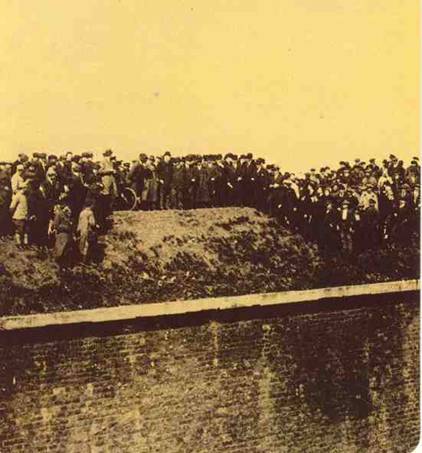
« La Zone »
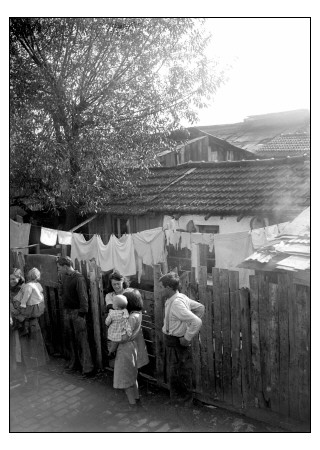
« La Zone »
Le boulevard militaire permet la création d'une large
rocade intérieure: le boulevard des Maréchaux, à l'est de la porte de Clichy, le
boulevard a reçu le nom du maréchal d'empire Jean-Baptiste Bessières.
|
| |
En 1922, un centre de plein air est construit par le Duc
d’ISTIERS au milieu des fortifications dans le vieux bastion 42. Ce centre est
créé pour recevoir les enfants chétifs de la ville de Paris.

Centre de
plein air du bastion 42 en 1922

Plan des Batignolles
en 1922
|
| |
En 1930, pratiquement toutes les fortifications sont rasées,
la construction sociale est avancée. Subsistent seulement jusqu'à cette date
les passages de l'octroi dont celui de la Porte de Clichy, qui poussent les
industriels à s'établir dans la proche banlieue, en particuliers à Clichy.
Les besoins d'espaces plus vastes accélèrent le
phénomène de desserrement. Une nouvelle phase de l'histoire des Batignolles et
des Epinettes s'amorce, celle d'une conquête par les immeubles d'habitation alors
que dans cette banlieue de Clichy se prépare l'apogée industrielle.
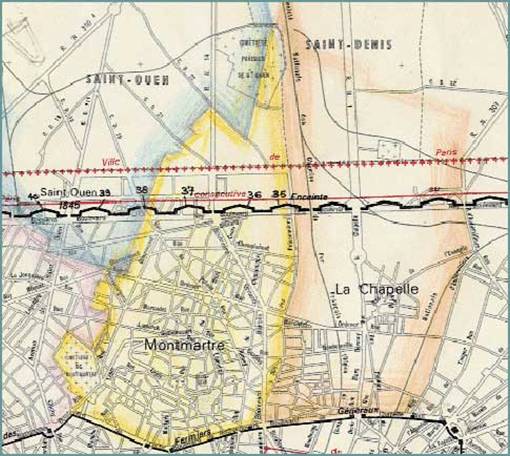
Ce plan
montre l’état des communes de Saint-Ouen, de Saint-Denis, de Montmartre et de
La Chapelle au moment du passage de l’enceinte bastionnée. Le “mur des Fermiers
généraux” est encore en fonction. La ligne rouge figure la limite du décret du
1er novembre 1859 ; les croix rouges, la limite du décret du 27 juillet 1930.
Le bastion 43 quant à lui, reste vierge de nouvelles
constructions, le fossé y est néanmoins comblé, le casernement est détruit; par
contre en bordure du boulevard Bessières, un relief accidenté témoigne des
anciennes buttes gazonnées. Les seules réalisations se placent à l'est du
bastion 43: c'est une école primaire en briques rouges avec une maternelle et
des baraquements montés sur pilotis qui servent de dispensaire à la caisse des
écoles. L’ensemble des terrains du lycée actuel forment-ils un vaste terrain de
jeux et de détente pour les enfants des alentours.
Pour franchir sans danger le boulevard Bessières on
construit un passage souterrain. La seconde guerre mondiale éclate, l'école
primaire Bessières est fermée, elle sert d'abord de refuge à des militaires
polonais qui seront ensuite envoyés en Angleterre. Avec l'occupation allemande,
l'école primaire devient un important QG, les Allemands font du bastion 43 un
terrain d'exercices.
|
| |
En 1937, le groupe scolaire « Bessières » remplace
le centre de plein air. Il est appelé comme cela, parce qu’il se trouve sur le
boulevard Bessières. Dans les années 30, toutes les écoles construites sur les
boulevards maréchaux sont en briques, et des arbres sont plantés à proximité.

Ecole
Bessières en 1937

Cour de récréation
Bessières en 1937
L'ensemble du terrain est entouré de barbelés à
l'exception d'un espace situé sur la partie est du lycée, jusqu'à l'école
primaire qui est laissée pour la récréation des enfants du quartier que leurs
mamans surveillent, installées près des murs de l'école.
A l'ouest, près de la porte de Clichy, l'ancien
bastion est percé d'entrées installées au ras du sol menant à des souterrains
qui semblent avoir servi à entreposer des armes.
|
| |
En 1938, le bastion 39 est rasé, on en profite pour rénover l’hôpital Bichat
et l’agrandir.
|
| |
En 1939, cette année commence le début de la destruction de « La
Zone »
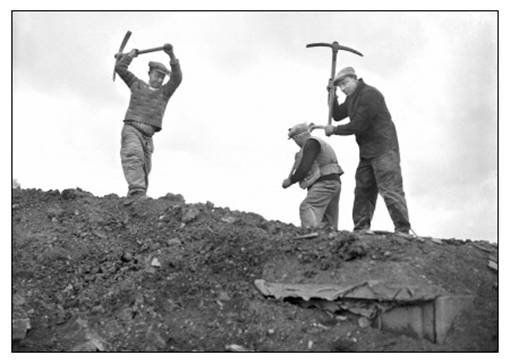
Destruction
de « La Zone »
|
| |
En 1940,

Place Clichy
en 1940

Porte de Clichy 1940
|
| |
Le 26 août 1944, l’hôpital Bichat est bombardé par les Allemands. Le pavillon
d’habitation du personnel hospitalier en bordure du boulevard Ney est détruit.
On déplore 10 morts et 3 blessés parmi les employés de l’hôpital.
|
| |
En 1945, avec la libération, le camp allemand reste entouré
de barbelés, car il est miné. Les opérations de déminage ont semble-t-il,
commencé par l'est, aussi la partie proche de la porte de Clichy, limitée par
la rue Saint-Just crée avant la guerre, et qui coupe le collège actuel du reste
de l'établissement, demeure interdite.
La « Zone » est complètement détruite.

Communiante sur les buttes gazonnées du
bastion 43 en 1945
|
| |
En
1948, de nouvelles constructions
apparaissent sur le bastion 43. Les habitants du
quartier des Epinettes, en bordure du boulevard, à la porte de Clichy, voient
surgir des baraquements préfabriqués.
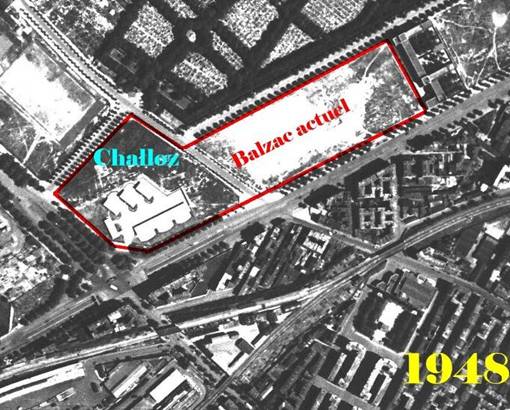
Photo aérienne de 1948
|
| |
Pendant les années 1950, la présence de la boucle du terminus de la ligne de métro 13
bis à la porte de Clichy, passant sous le collège actuel a nécessité des
travaux particuliers. Il faut enjamber les tunnels du métro par des sortes de
ponts jetés sur des piles qui descendent au niveau des souterrains. Le long de
la façade nord, deux galeries de service superposées longent un mur qui porte la
façade. Le prolongement futur de cette ligne de métro est prévu.
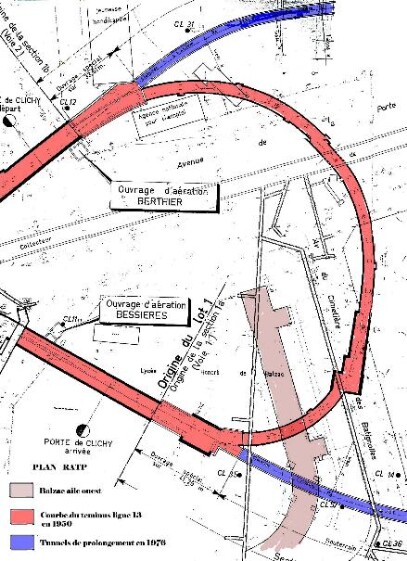
Boucle du terminus métro 13bis
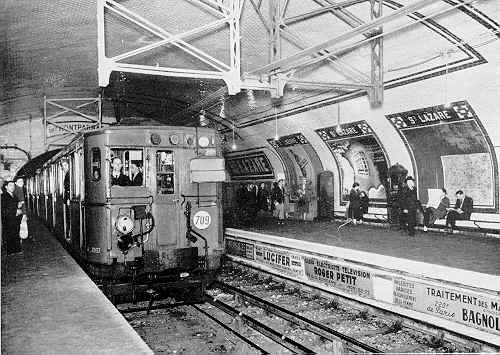
Rame Nord-Sud sur la ligne St Lazare
– Pt de Clichy
|
| |
En
1952,

Lycée
Balzac en 1952
|
| |
En
1954, le
quartier des Epinettes en forme de V limité par l'avenue de Clichy, l'avenue de
Saint-Ouen est peuplé de 60803 habitants sur 137 hectares à un aspect plus
populaire, et c'est sur ses bords que le lycée va être construit, ce quartier
garde encore au nord-est une forte zone industrielle et artisanale avec de
nombreux garages, seul exception l'enclave de la cité des Fleurs, bordée
d'agréables maisons de villes précédées de petits jardins à l'aspect cossu.
Au sud, un tissu d'immeubles haussmanniens s’établi.
Aux catégories sociales fortement représentées, employés et ouvriers qualifiés
s'ajoute celle d'ouvriers non qualifiés et de manoeuvres.
Les indices de revenus imposables sont faibles 83 à
88 sur une échelle allant de 76 à 180 sur l'ensemble de Paris, les prix de
l'immobilier sont parmi les plus bas comme ceux de l'est de Paris: les appartements
de 1 à 2 pièces dominent, 54% des appartements n'ont pas de WC intérieurs, il
existe un fort pourcentage de meublés.
|
| |
En 1957, pour développer un enseignement technique
du second degré dans les domaines de l’administration et de la gestion des
entreprises, du commerce et du tourisme l’École Nationale de commerce (E.N.C.)
est construite boulevard Bessières.

ENC en 1957
|
| |
En 1962, le quartier des Epinettes est l'un des rares qui voit sa
population encore augmenter, elle atteint son maximum avec 63383 habitants. Ce
quartier est en phase avec le baby-boom de la seconde guerre mondiale alors que
Paris a déjà amorcé son vieillissement. Forte fécondité, plus forte mortalité,
jeunesse de la population telles sont les caractéristiques de ce quartier.
Le taux de fécondité reste élevé 2, 1 à 2, 3 par
femme en âge de procréer par rapport à la moyenne parisienne qui est de 1,99.
L'indice de mortalité compris entre 116 et 122 pour un indice moyen parisien de
100 est également fort. L'âge moyen de la population est inférieur à la moyenne
de Paris qui est de 39,2 ans, soit 36ans, et la population étrangère est une
des plus faibles de Paris.
Ainsi tant en ce qui concerne la démographie que la
population active, le cadre de vie, le quartier des Epinettes est représentatif
d'un lieu de transition parisien plus tourné vers l'est que vers l'ouest,
encore enraciné dans le passé des quartiers périphériques de la ville.
L'évolution des années 1950 à 1960 ne retouchera pas ce tableau.
|
| |
En 1965,

Boulevard
Bessières 1965

Boulevard Bessières 1965
|
| |
En 1966,
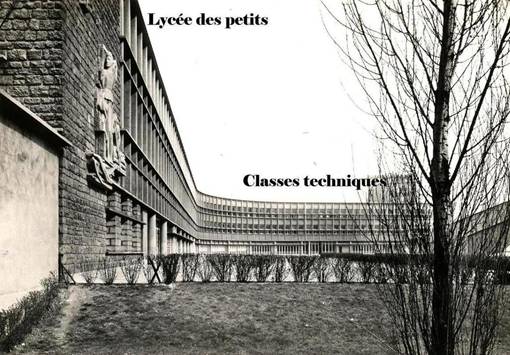
Lycée
Balzac 1966
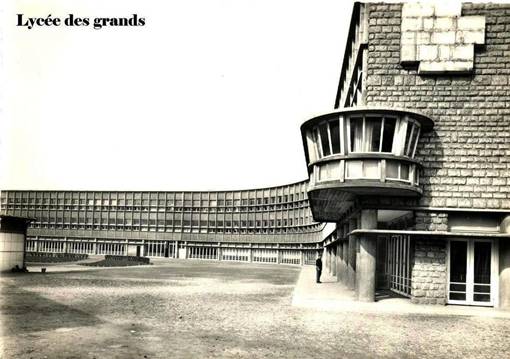
Lycée Balzac en 1966
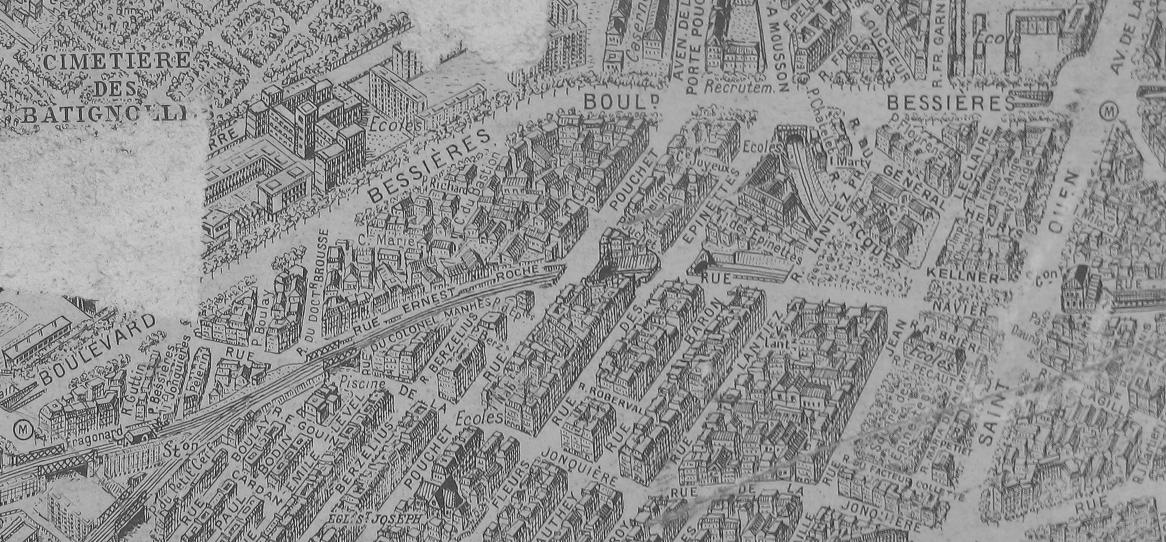
Plan du bd Bessières en 1966 (cliquer ici pour agrandir le plan)
|
| |
En 1976, débutent les travaux qui doivent conduire la ligne 13 bis de la porte de
Clichy, jusqu'à la station Asnières–Gennevilliers en proche banlieue. Deux
décrochements à partir de la boucle du terminus sont créés. L'un d'eux provoque
la création d'un nouveau tunnel qui passe plus à l'est sous le collège. Ainsi, au rez-de-chaussée, on peut sentir, si l’on y
prête attention les vibration des métros qui passent…
|
| |
En
1977,
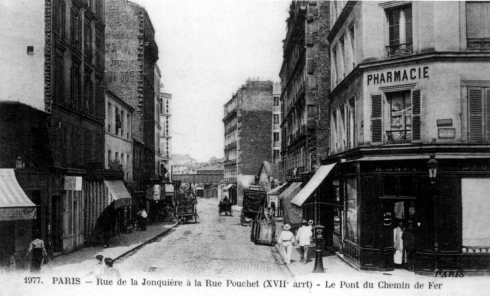
Angle de
la rue de la Jonquière et de la rue Pouchet 1977
|
| |
En 1980, le
square des Epinettes est agrandi et réaménagé. Construction de notre immeuble
au 65 boulevard Bessières.
|
| |
En 1987, le
bastion 44 de l’immense fortification qui par miracle est toujours existant sur
le territoire de Clichy, avec ses 300m de flanc à flanc, est le seul survivant,
dans son intégralité, des 94 bastions qui entouraient Paris en 1870. Il est
totalement égaré sur les vastes propriétés de la SNCF en arrière des anciens
ateliers de montage et de peinture des décors de l’Opéra. Un début de
démolition ayant été constaté cette année.
|
| |
En 1988, une
demande de classement du bastion 44 est déposée à la commission du Vieux Paris
sans résultat.
|
| |
En 1999,
après des études de programmation et de diagnostique demandé par le Ministère
de l’Intérieur, des travaux dans la caserne qui était occupée par le Ministère
de la défense sont entrepris, afin d’installer une partie des services de la
Préfecture de Police, au 46 boulevard Bessières.
|
| |
 Au XXIème siècle : Au XXIème siècle :
|
| |
En 2000, inauguration du nouveau Centre de Police au 46 boulevard
Bessières, qui rassemble la direction de la Police urbaine de proximité (8ème,
16ème et 17ème arrondissements de Paris), la direction de
l’ordre public et de la circulation (1er, 2ème, 8ème,
9ème, 16ème et 17ème arrondissements de
Paris), la direction de la Police judiciaire (1er, 2ème,
3ème, 4ème, 8ème, 9ème, 16ème et
17ème arrondissements de Paris).

Centre de Police en 2000
|
| |
En 2002, une nouvelle demande de classement du bastion 44 est déposée à la
commission du Vieux Paris, toujours sans résultat.
|
| |
En 2005,
suppression des deux souterrains pour les piétons situés boulevard Bessières
(au niveau de la rue de la Jonquière et de la rue Paul Brousse). Elargissement
des trottoirs du boulevard. Généralisation du stationnement payant.
|
| |
En 2007,
rénovation de l’École Nationale de Commerce. Création d’une station de
location de vélo, de type Vélib’ sur le boulevard Bessières.

Dessin du projet ENC 2007
|
|